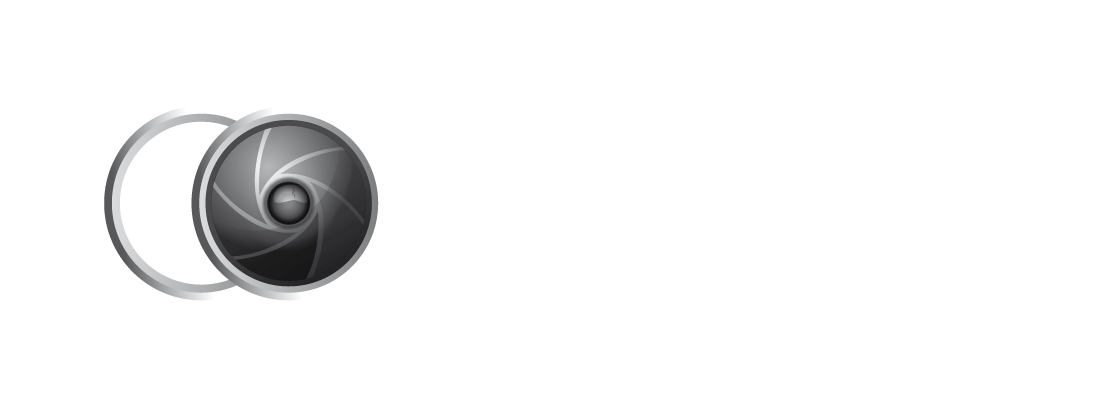Aujourd’hui, nous vous présentons un nouvel outil communautaire : Fulgur’Zone !
Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? A qui cela s’adresse ? Qui l’a créé ? Nous avons pu tester l’outil ces derniers jours, on vous explique tout !
Qu’est-ce que c’est ?
Fulgur’Zone naît d’une idée simple : sortir nos plus belles captures d’éclairs de l’oubli des réseaux sociaux pour en faire une ressource utile, accessible et durable. En quelques clics, chaque photographe peut contribuer à une carte des impacts de foudre et faire progresser, avec ses images, la compréhension d’un phénomène aussi spectaculaire que rare à documenter.
Derrière ce nouvel outil, il y a Eric Tarrit, photographe-réalisateur, depuis longtemps passionné par les orages. Son travail allie patience, savoir-faire et sens de l’éphémère. Fulgur’Zone s’impose ainsi comme le prolongement naturel d’un parcours où l’esthétique sert l’observation et où l’outil collectif prolonge la prise de vue individuelle.
Accéder à Fulgur’Zone
À quoi ça sert ?
Concrètement, Fulgur’Zone est une carte interactive libre et gratuite pensée pour l’observation et l’analyse. L’interface s’accompagne d’une timeline qui permet d’explorer les événements dans le temps. Les impacts sont classés selon le matériau touché (du sol aux infrastructures électriques) afin de mettre en avant les différences de comportement de la foudre selon les supports. Des badges mettent en évidence des phénomènes remarquables, comme les “Power Flash” liés aux surtensions sur les réseaux, ou les traceurs ascendants qui remontent vers le nuage, facilitant l’identification rapide des cas rares.

L’intérêt de l’outil tient autant à sa méthodologie qu’à sa finalité. L’auteur assume des critères d’acceptation exigeants afin de recentrer les contributions sur la zone d’impact et les phénomènes adjacents. Le parti pris est clair : privilégier l’information visuelle utile plutôt que la seule esthétique du coup de foudre. En pratique, cela signifie des cadrages serrés, des détails visibles au sol et la possibilité de rattacher des éléments contextuels comme une animation radar ou des données de foudroiement quand elles existent. Cette discipline collective produit une base cohérente, exploitable à la fois par les passionnés, les chasseurs d’orages et le monde de la recherche. Pour lever les doutes en amont, un serveur Discord permet de soumettre une image “avant publication” et d’obtenir un retour de la communauté. Les contributeurs conservent leurs droits d’auteur, l’usage étant explicitement scientifique et éducatif, sans vocation commerciale.

A noter, chaque point GPS possède des champs dédiés à la polarité et à la puissance de l’impact. Pour une lecture simple, un code visuel simple s’applique sur la carte. Un cercle rouge pour une polarité positive, bleu pour une polarité négative, et grisé lorsque l’information manque. La puissance, lorsqu’elle est renseignée, apparaît dans la fiche associée afin d’affiner l’analyse des scènes. Par ailleurs, un système de “mise en avant” est disponible. La communauté peut voter pour les observations les plus remarquables, elles sont ensuite mises en avant et faciles à repérer lors de l’exploration. Enfin Il est possible d’autoriser le partage sur les réseaux Fulgur’Zone et d’indiquer votre nom d’utilisateur pour être mentionné.
Et ensuite ?
À l’usage, la carte deviendra un vrai terrain d’étude partagé. On pourra l’utiliser pour comparer l’effet d’un impact sur une pelouse détrempée versus un affleurement rocheux. Cela permettra de voir la signature lumineuse d’un Power Flash près d’une ligne. On pourra également isoler des séries sur une zone donnée et l’on suivra la chronologie d’une séquence orageuse. La promesse est double : donner une seconde vie aux “pépites” de terrain et constituer, au fil des saisons, une mémoire visuelle et géolocalisée des impacts qui échappent souvent à l’archivage, parce que recouverts par la végétation ou tout simplement noyés dans le flux des réseaux sociaux.
Accéder à Fulgur’Zone
Fulgur’Zone a besoin de vous, de vos photos et de votre rigueur. La prochaine fois que vous capturez un impact, pensez “donnée” autant que “photo”. Situez précisément, cadrez l’aire touchée, décrivez les conditions, signalez les phénomènes associés. Et si vous hésitez, passez par le serveur Discord pour un coup d’œil collégial avant publication. Chaque contribution renforce la carte, inspire d’autres pratiquants, et nourrit une base qui profitera autant à la communauté qu’aux météorologues et aux chercheurs !